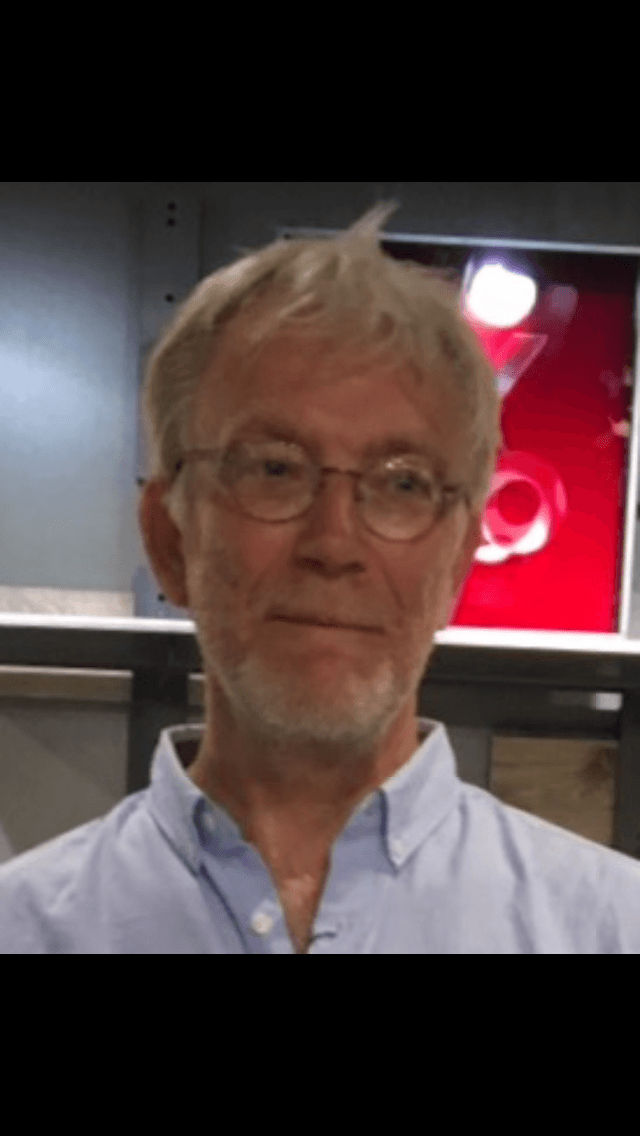DR
Il est de ces moments de grâce où l’excès nous transporte, le dépassement des lignes autorisées et l’ignorance volontaire des tabous nous met en joie, un élan Bérurieresque (pour ceux qui se souviennent de San Antonio). “Tarquin”, c’est cela : une scène noyée par l’orage tropical (mais où sont les crapauds ?), un plongeur qui sort d’un trou d’eau, un marteau piqueur pour déterrer un mort, un incendie et des cigarettes, une juge écrasée de chaleur…
L’intrigue ? Un dictateur est mort il y a quelques années. Mais est-il vraiment mort ? L’exhumation du corps ira-t-elle de pair avec la résurrection des complicités et des lâchetés ? C’est un opéra théâtre… et jamais l’accolade ne fut aussi justifiée : personnages archétypes dont le jeu exacerbe les traits de personnalité, densité de l’intrigue, moyens de visualisation concrets et d’une présence folle, loin des captations vidéos qui excuse la faiblesse du jeu et du dire, un moment de jouissance pour les amateurs de ce théâtre excessif et goûteux.
Servi par une musique jouée au cordeau, partition originale mêlant baroque et sud-américanisme tangué, des acteurs chanteurs parfaits dans leur présence et leur puissance, comment ne pas évoquer les mânes de Romain Gary et ses détonants « mangeurs d’étoiles » déjà contrepoints absurdes d’un autoritarisme sans issue ? Ou « Cent ans de solitude » où toute la folie du monde semblait devoir jaillir des personnages envahis de cette folie moite des villes perdues dans la forêt ? Ou même J. G. Ballard et ses naufragés de l’humidité brûlante envahissante et destructrice des œuvres de l’homme ? Tous ont en commun cette politesse exquise du désespoir. Et cet humour dévastateur qui apporte extase à l’homme de bien.