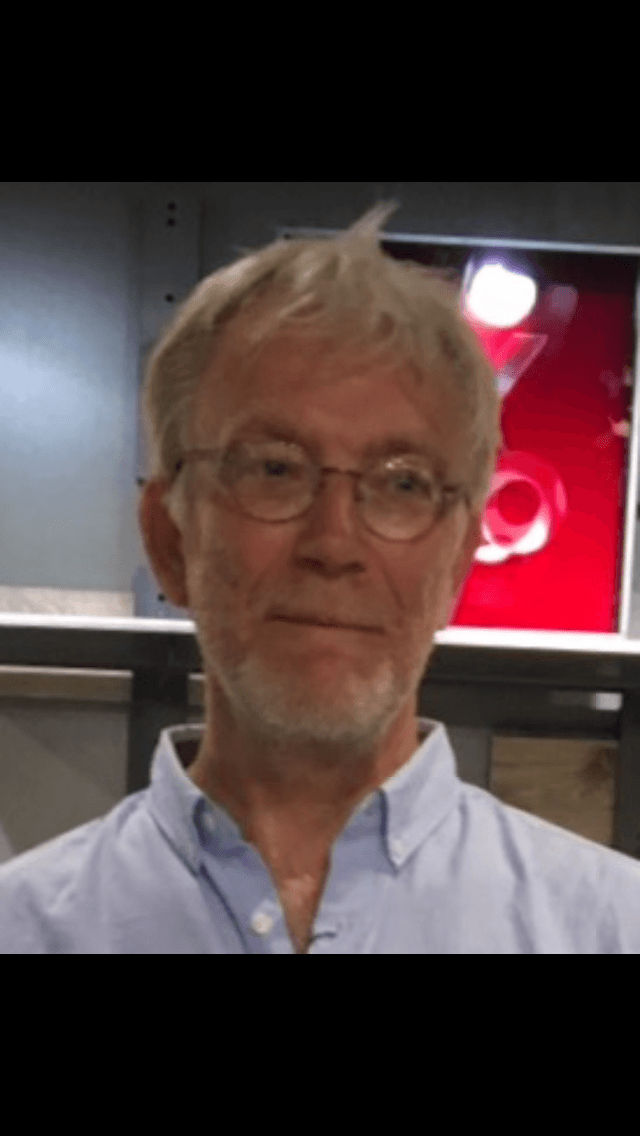DR
L’anxiété a saisi l’humain depuis sa chute de l’Eden. Qui n’a de cesse depuis de trouver pansements et cautères pour apaiser l’égarement qui le saisit. La première partie expose les gimmicks communs, talismans du traitement du symptôme : psy, médocs, réussite sociale, sexe compulsif. Et leur rôle désormais clair dans la consolidation de sa névrose, soi-disant dès lors assumée mais à un prix sans nom : l’enfermement en soi et la solitude générée par son habitus. On assume. Et on souffre. C’est là où le quatuor de Ligeti, œuvre diabolique géniale de stridences et d’inconfort, virtuose, prend son envol. Il n’y a ni silence ni douceur dans être mal. Il y a de l’atonalité, de l’excès de triples croches, des glissando et des envolées loin, si loin sur la touche d’ébène. Chaotique et noir.
La seconde partie débute par l’effondrement d’un mur de chaises, symbole peut-être de ces remparts illusoires constitués de « trucs et astuces » pour aller au vrai de chacun en abandonnant l’illusion. L’œuvre de Beethoven surgit, prend une chaleur et une résonance particulières. La folie vécue pleinement se fait alors douce, l’homme d’affaires ira jusqu’à reproduire Pasolini dans la scène finale de son génial « Théorème », la sex-addict à s’abandonner à l’érotisme et à la tendresse, la mère de l’enfant mort au refuge des dessins enfantins. C’est une pièce dont on ne sort pas indemne. Tantôt clairement saisi par un effroi devant l’inéluctable de la névrose humaine, plus tard entraîné en douceur par cette perspective d’assumer comme fruit de la vie une identité hors normes sociales et vivre ce bonheur d’être soi si loin de la convention acceptable.