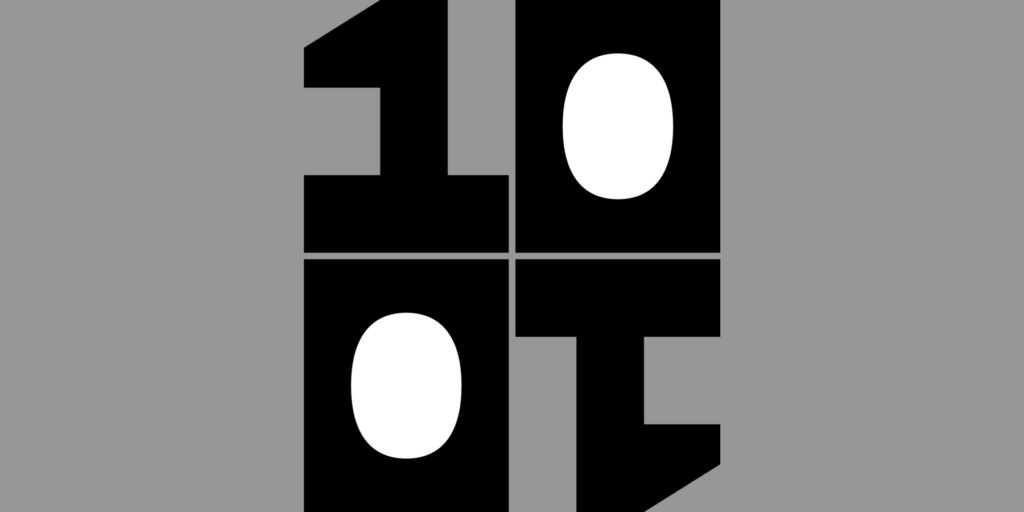
À l’occasion du colloque international Le Musée au défi, qui tentait de cerner le rôle de l’innovation numérique dans les musées, Arsenic, scène contemporaine de Lausanne qui prend des risques, a présenté deux soirées de performances d’artistes questionnant l’œuvre d’art et son inéluctable extension numérique. Prendre le temps de s’interroger sur les pratiques performatives et leur porosité avec les nouvelles réalités hyperconnectées, vaste programme.
Le travail bien connu du chorégraphe suisse Gilles Jobin paraît presque évident dans ce décor. Avec « VR_I », il invite le public à une expérience sensorielle qui se multiplie aujourd’hui à chaque carrefour de nos capitales. Équipés de casques de réalité virtuelle, cinq visiteurs à la fois peuvent naviguer librement dans un monde peuplé de danseurs virtuels. Ils explorent cet univers, évoluant tour à tour dans un désert à perte de vue, un paysage urbain, ou encore à l’intérieur d’un loft au sommet d’une montagne. Oui ça fait son effet, mais que reste-t-il de l’expérience au-delà du spectaculaire ? Que reste-t-il d’artistique dans ce geste ? Il faudra sans doute le vivre plutôt comme une session introductive, où seuls les non-initiés seront émoustillés.
À l’étage, une tout autre relation au monde se joue en continu. Ryan Trecartin est l’un des artistes les plus radicaux de la net generation. Ses vidéos sont comme des émissions de téléréalité qui auraient été tournées par des mutants extraterrestres. Êtres vivants ou animations, hommes ou femmes, présent ou avenir… Inutile d’y chercher une logique. On le vénère autant pour son esthétique kitch et carton-pâte qu’on lui reproche une œuvre indigeste comme shootée à une consommation immodérée de boissons énergétiques. L’artiste américain impose une cadence et une grammaire en s’appropriant certains topoï du monde des médias. Dans ses « movies » se cognent dans un joyeux et effrayant amalgame les dynamiques des reality shows mêlées à des slogans publicitaires et à des dialogues de sitcom, montés en un flux unique sur un rythme infernal. « Temple Time », présenté ici, est l’une de ses plus récentes créations ; elle évoque un show de téléréalité hanté durant lequel des chasseurs de fantômes évoluent au sein d’un temple maçonnique. Du surréalisme numérique pur jus qui peut laisser froid ou à distance, mais qui s’avère être un maillon solide de l’hypnotique célérité avec laquelle les artistes doivent se confronter.
Et comme pour démentir cette fuite en avant, l’artiste américano-bolivienne Donna Huanca conçoit une performance méditative durant laquelle deux performeurs aux corps peints s’engagent dans un long dialogue visuel et sonore avec un monolithe de glace en fonte avec feuilles de chou intégrées. Dans cette installation-performance, le maquillage transforme le corps humain en objet ; la cérémonie de la mise en scène de soi ne vise plus alors à s’inscrire dans un rapport d’altérité, mais de dissimulation, de fusion, de camouflage. La dimension spirituelle de la peau interroge le discours contemporain du corps, l’espace-temps de la métamorphose hésitant entre renaissance et dépersonnalisation. Les attitudes extatiques ou impavides des modèles les font sans cesse évoluer du recueillement au retrait, jusqu’à une vulnérabilité du fait de leur surexposition et de la tyrannie de la transparence. Ainsi, camouflage et travestissement opèrent un jeu constant de brouillage entre prédation et séduction, volupté et cruauté. Sacralisés et élevés sur des podiums, les corps et les objets deviennent allégories et mettent en parallèle les rituels du self-care contemporain avec des réminiscences plus archaïques et primitives. Reste la jouissance enfantine de regarder la glace devenir eau et l’imposant totem se scléroser peu à peu.
Ce qu’ont réussi les deux curateurs de ce programme performatif, Élise Lammer et Patrick de Rham, c’est la variété des formes proposées, qui témoignent de façon évidente de la complexité et de la richesse de la problématique du numérique dans l’art. Loin d’un cantonnement dans un discours prosélytique, il était question de ne fermer aucune porte et de s’engager sur tous les chemins qui ne mènent encore nulle part. La beauté du geste est dans cette quête que l’on entreprend avec envie sans savoir si l’issue sera lumineuse ou crépusculaire. Un peu comme le performeur PRICE qui, dans un solo à vif, transmet physiquement la sensation de cette désorientation face au non-connu et au non-maîtrisé. Car il revient aux artistes de créer le désir d’explorer des terres réellement inconnues et de nous y accompagner.
