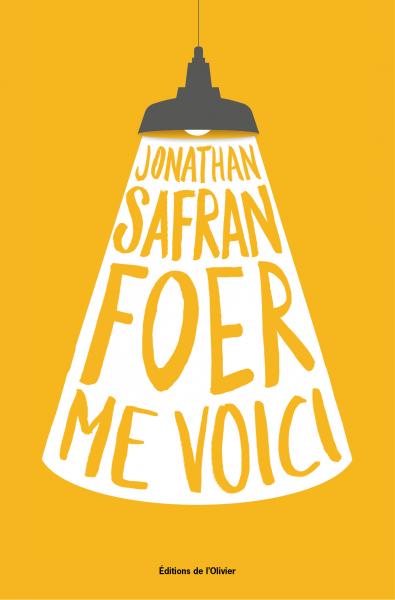
DR
Trois romans et un essai en quinze ans : on ne peut pas vraiment dire que Jonathan Safran Foer soit un auteur prolifique. Mais chaque publication de l’écrivain américain est à marquer d’une pierre blanche : tel est le cas de « Me voici », dont la traduction française vient de paraître aux éditions de L’Olivier.
La famille Bloch, double fictionnel de celle de l’auteur dont le divorce d’avec la romancière Nicole Krauss date de 2014, vit un moment de crise qui présage la dissolution prochaine du couple de quadras hipsters new-yorkais Julia et Jacob. Alors quoi, plus de 700 pages pour ce pitch éculé et vaguement autobiographique ? Le talent de Safran Foer est de ne pas s’enliser dans un énième récit psychologico-réaliste, mais plutôt de décaler le réel pour le conduire à un endroit d’où il peut éclairer nos choix de vie, tout en l’entremêlant avec un enjeu socio-politique lié à Israël et au judaïsme aujourd’hui.
L’une des spécificités de l’écriture de Safran Foer, comme il l’avait déjà démontré dans « Extrêmement fort et incroyablement près » (2005) – faisant écho à « L’Attrape-coeur » de Salinger – est sa capacité à portraitiser l’enfance en créant des personnages mémorables, certes bien trop mûrs pour leur âge, mais permettant de démultipliant les effets de résonances avec le monde adulte. Les trois fils Bloch – Sam, Max et Benjy – sont les murs vivants auxquels se heurtent les interrogations et les souffrances de leurs parents, qui doivent se résoudre à admettre qu’après deux décennies de vie commune plus grand-chose ne les tient ensemble. La faille se manifeste par la divergence de leurs réactions lorsqu’ils apprennent que leur fils Sam a été suspendu à l’école, bien qu’il clame son innocence, pour avoir écrit des mots orduriers et racistes : « Le plus important, c’est de le croire », réplique Jacob (…) Non, fit Julia, le plus important, c’est de l’aimer. » Chez Jacob, la prise de conscience passe par une remise en question de sa position de « spectateur », dans son couple, mais aussi dans sa vie en général.
Car au-delà de la dimension relationnelle, c’est son positionnement à l’égard de son identité juive américaine qui est questionné, sa façon de la subir ou non comme une contrainte généalogique : familialement, communautairement, il semble pris entre des injonctions contradictoires : « Tout se résumait à des choses dont il ne fallait jamais se souvenir, ou qu’il ne fallait jamais oublier. » Car « chez les Juifs, le nom est toujours rattaché à une signification. – A une souffrance, tu veux dire. » Cette part de souffrance, transformée en agressivité par son père Irv, crispé sur ses rancœurs réactionnaires, trouve l’occasion inattendue et décisive d’être transcendée à l’occasion d’une catastrophe dystopique : un tremblement de terre ayant ravagé une partie du Proche-Orient, provoquant une crise humanitaire sans précédent, ses voisins déclarent la guerre à Israël qui se retrouve bientôt à feu et à sang… On trouve dans « Me voici », comme chez Philip Roth ou Saul Below, des pages d’humour juif aussi cruel qu’irrésistiblement drôle. Ainsi Irv rabrouant Jacob à propos de son petit-fils Sam : « Vous avez eu une discussion ? Tu crois que c’est en discutant qu’on est sortis d’Egypte ? (…) La discussion, ça vous assure la meilleure place dans la file d’attente d’une salle de douches qui n’en est pas une. »
Mais au-delà des déchirements et des violences réelles ou symboliques, « Me voici » est d’abord l’expression d’une littérature consolatrice. « La distance béante entre l’endroit où l’on est et celui où l’on a toujours imaginé être n’est pas forcément synonyme d’échec. La déception ne nécessite pas d’être décevante. » Voilà qui rappelle Henri Michaux et son exhortation à accepter sa part d’ombre et de défaite : “Va, tant qu’il est possible, jusqu’au bout de tes défaites, jusqu’à en être écœuré. Alors, la magie partie, les restes – il doit y en avoir – ne t’abîmeront plus”, lisait-on dans “Poteau d’angle”. Consolateur aussi dans le vécu de sa déchéance amoureuse, car « il n’y a rien de plus entier qu’un cœur brisé » affirme Jacob, qui aurait pu tout autant rappeler le proverbe zen : « Seule la feuille qui tombe est une feuille totale. » Cette chute, le judaïsme l’a au fil des siècles intégré dans sa chair. Non pas la chute du péché originel, mais celle provoquée par le vide laissé par le dieu absent – le tsimtsoum des cabalistes.
Cette défaillance du monde est la source d’un malentendu persistant avec soi-même, et l’objet d’une des plus belles phrases du roman : « Le problème, c’était le monde. C’était le monde qui ne lui convenait pas. Mais a-t-on déjà trouvé le bonheur en rétablissant la vérité sur la culpabilité du monde ? » La culpabilité, à défaut d’être anéantie ou acceptée, sera rejetée sur l’autre ou sur soi-même ; mais soi-même, comme le pressent justement Jacob, n’est alors qu’une forme différente d’autre : « C’est ma vie, mais ce n’est pas moi », énonce l’une des répliques-clés du livre, qui sonne comme l’amer regret de ne pas être à son endroit juste. Cet endroit, c’est celui-là que l’on cherche sans doute toute sa vie. Mais cette quête n’est possible qu’à condition de vivre pleinement sa présence au monde : c’est tout le sens du titre du roman, inspiré par l’histoire biblique du sacrifice d’Abraham : « Hineni », dit-il en hébreu à Yéovah, me voici.
Jacob « détestait la vérité, détestait le mensonge, mais ne connaissait rien entre les deux. » Et cet entre-deux obscur, c’est peut-être cela, la littérature, ce « mentir-vrai » d’Aragon. Safran Foer est aujourd’hui l’un des écrivains américains les plus saisissants. Il signe avec « Me voici » un récit aussi brillant que drôle et bouleversant. Et pour paraphraser Jacob : « Sa synagogue à lui est faite de mots. » Nous voici à l’intérieur.
« Me Voici », de Jonathan Safran Foer, éditions de L’Olivier (traduit de l’anglais par Stéphane Roques), septembre 2017, 741 p., 24,50 €.
