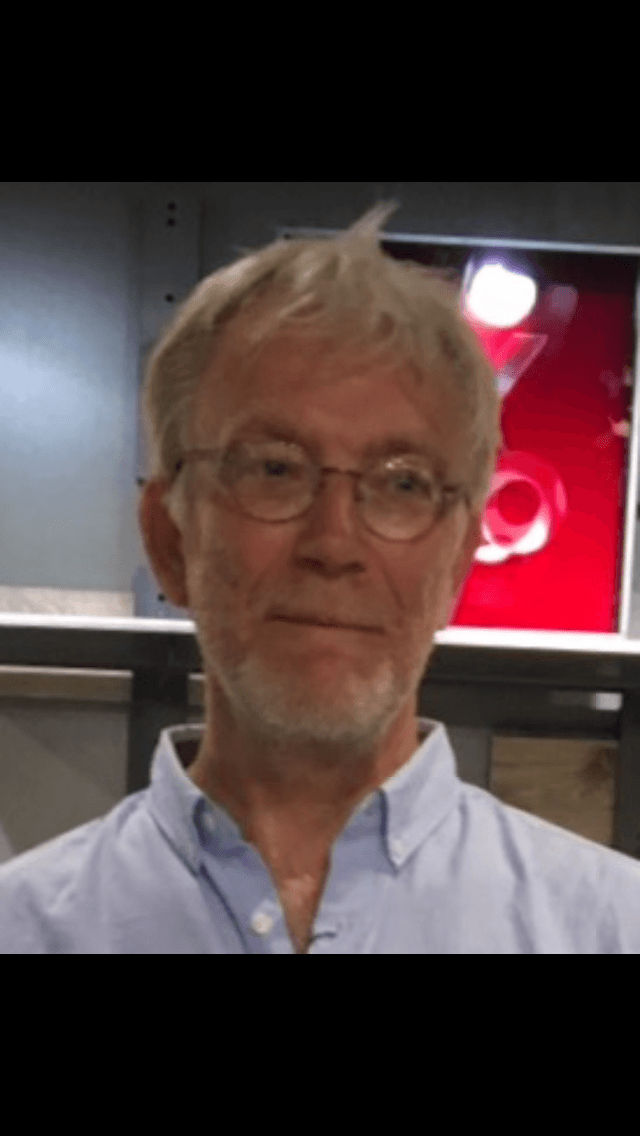© Yanick Macdonald
Dans un pavillon de la banlieue québécoise, gris, devant lequel est garée une voiture, grise, qui emmènera chaque matin à un job sans odeur ni saveur et ramènera le soir la mère. La fille, elle, essaie de se faire une place dans un monde qu’elle vomit et qu’elle consomme. Sans véritable prise sur le réel, elles s’abandonnent toutes deux aux écrans qui occupent l’espace. Les liens se font virtuels. D’autant plus puissants et tentateurs qu’ils ne permettent qu’une relation désincarnée avec les tiers, sans odeur, sans saveur, sans vérité.
La fille convoque un personnage à son image, Antigone, morte emmurée il y a deux mille cinq cents ans pour cause de révolte un peu trop appuyée, un peu trop affirmée. Jiminy Cricket acide et insolente, Antigone est là pour marquer la répétitivité des histoires, de l’histoire. La fille finit par fuir, rejoindre Daesh, trouver un sens, s’abandonner à cet amoureux virtuel qui a sûrement un sourire si doux et des mains si belles. Qui l’emmènera dans les contrées d’Orient, où elle trouvera un sens. Arrivée à Antioche, elle croise le fantôme de sa mère, immigrée inverse vingt ans plus tôt, fuyant l’odeur de la mort qui imprègne tout le pays.
C’est une pièce qui traite de l’inéluctable, du répétitif, de ce moment de la vie où la sensibilité devient tellement extrême que tout doit changer, qu’importe le danger, qu’importe la mort. Qui donne une légèreté et un rire, en contraste bienfaisant avec l’angoisse exprimée, qu’accentuent encore l’énergie joyeuse et la présence puissante des trois actrices. Mention spéciale à Sarah Laurendeau, qui explose en Antigone gouailleuse, irrévérencieuse (elle ira jusqu’à refuser le repos éternel…) et très drôle. Au final, une bouffée d’énergie rageuse et joyeuse qui fait un bien fou malgré la gravité des sujets.