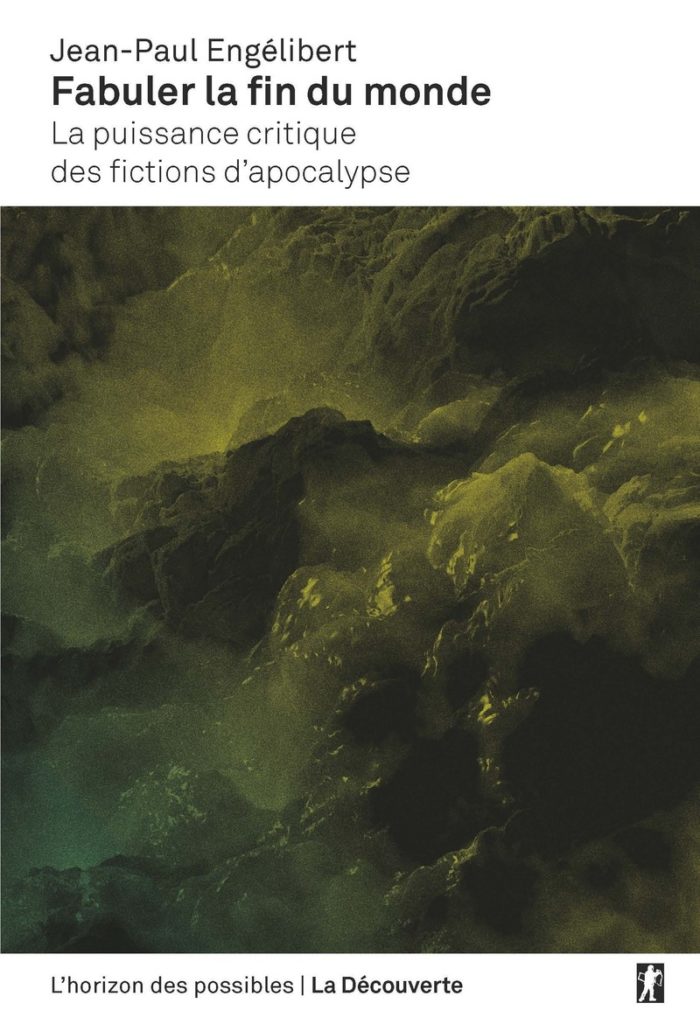
Dans le « Cœur de l’Angleterre », traduit en français en cette rentrée, Jonathan Coe réduit la conception stendhalienne d’un roman du plan large promené sur les routes, parlant implicitement d’un « miroir minuscule » à propos de la chronique sociale imparfaite qu’il est en train d’écrire. Au rebours de cette focale déceptive et de cette supposée tendance de la littérature actuelle à « prendre la lorgnette » (comme le formulait récemment Lucile Commeaux dans l’émission « La Dispute » de France Culture), les romans de la fin du monde qu’abordent Jean-Paul Engélibert dans son nouvel ouvrage (qu’ils soient français ou étrangers, modernes ou contemporains) déplient pour leur part des projections audacieuses, défigurantes et fragiles, qui invitent à « regarder l’histoire depuis l’après » (p. 92), contrer la tyrannie du présentisme pour transformer « la durée indifférente du temps en agenda » (p. 15). Professeur à l’Université Bordeaux Montaigne, Jean-Paul Engélibert publie ici son premier ouvrage personnel dans une édition grand public, réflexion qui retravaille ses récentes communications universitaires et prolonge directement ses « Apocalypses sans royaume » parues chez Garnier en 2013. La perspective comparatiste y est requalifiée en projet essayiste : convoquant Adorno, Deleuze et Guattari, Engélibert évoque sans fausse modestie l’ambition d’une « critique mineure » (p. 19) consistant en un croisement inquiet des médiums et des disciplines (sociologie, série télévisée, philosophie, littérature, cinéma…)
Si une idée générale pouvait réunir les sept thèses finalement résumées par l’essayiste, c’est celle d’une réhabilitation du politique permise par la fabulation apocalyptique, au sens où celle-ci élargit et dérègle les perceptions présentistes et façonne de nouveaux modes d’intelligibilité du monde. Les œuvres très variées convoquées par Engélibert permettent de creuser énergiquement cette hypothèse selon des modalités toujours renouvelées, les chapitres mettant autant en avant des problématiques conceptuelles (apocalypse et anthropocène, immanence et imminence) ou historiques (« Faire monde au temps des cyborgs ») que des considérations plus artistiques (« Temps messianique et cinéma »). Si l’on peut regretter que certains passages (surtout dans les derniers chapitres) privilégient l’analyse textuelle et picturale (toujours fine et accessible) au risque de paraître plus anecdotiques, c’est dans cette attention généreuse au médium artistique que réside la grande force politique de l’essai. Déjouant d’entrée « le grand récit de l’anthropocène » (p. 31) pour révéler la valeur prophétique de fictions aujourd’hui méconnues (« Le Dernier Homme » de Grainville en particulier, paru en 1805), Engélibert suggère une contre-histoire des idées tout à fait passionnante, sans vanter emphatiquement les pouvoirs utopiques de la littérature. Cette « apocalypse critique » dont les écrivains font preuve (de Margaret Atwood à Antoine Volodine) est finalement celui d’Engélibert : dans le temps rouvert de l’essai qui reconfigure la pensée, dans cette rigoureuse indiscipline qui remet la critique en conscience (le « je » réapparaissant symboliquement dans la conclusion) on reconnaît ces « formes de la connaissance » (p. 27) que sont les fables apocalyptiques, celles qui n’offrent, comme le formule Volodine dans « Frères sorcières », qu’une « épissure » noire à détricoter, « en dépit de la nuit. »

